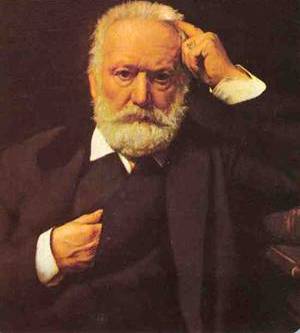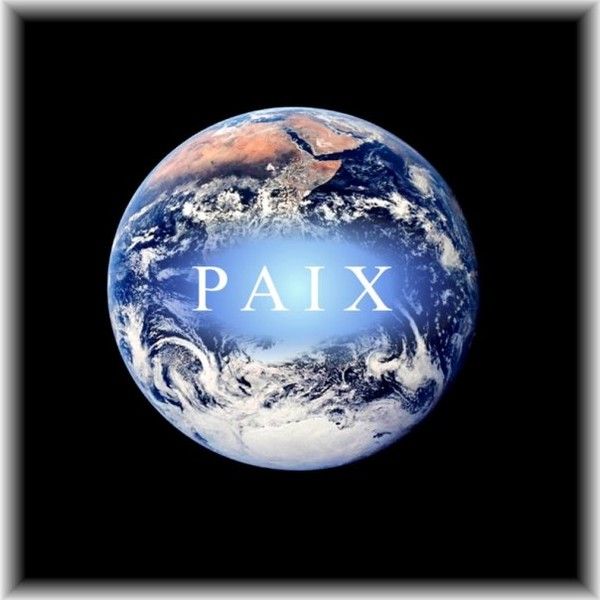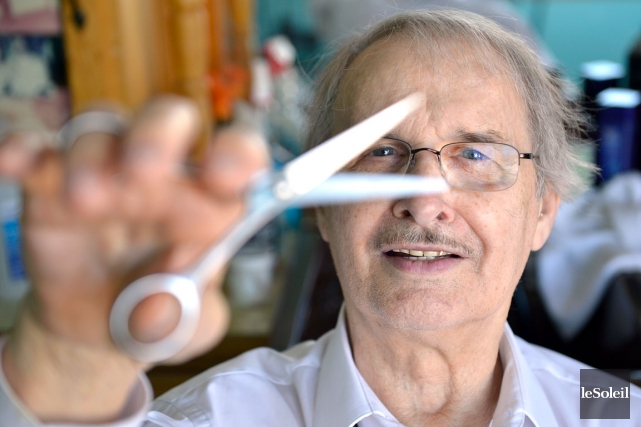Article de Robert Joumard et de Mouloud Haddak, février 2015
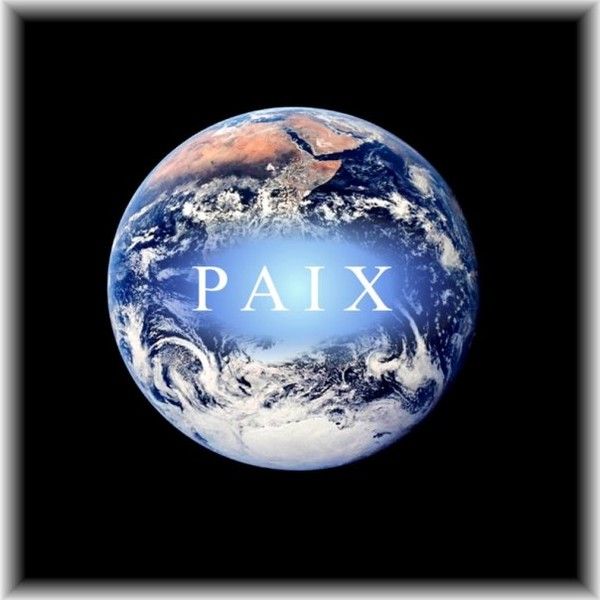
« Il faut combattre le racisme, les inégalités sociales et le dogmatisme religieux »
Un boulanger d’origine tunisienne reçoit des menaces et la vitrine de
son magasin est détruite ; un jeune d’allure maghrébine se fait
insulter dans la rue ; une jeune beurette se fait traiter de pute. Bien
que ce soit des agressions contre des personnes de culture
arabo-musulmane, ce ne sont pas des agressions « islamophobes » car les
agresseurs sont eux-mêmes de culture arabo-musulmane. Mais ces
agresseurs n’admettent pas que des immigrés maghrébins ne respectent pas
l’interdiction de vendre du jambon ou de l’alcool, ils veulent
interdire à tout citoyen dont les grands parents ont émigré d’Algérie de
manger pendant le ramadan et veulent imposer le code vestimentaire
actuel d’une partie des musulmans pratiquants à toute fille de culture
arabo-berbéro-musulmane, comme nous en avons été témoins.
En parallèle, ces pratiquants musulmans qui s’affichent sont victimes
d’attitudes hostiles de la part d’une partie de la population et
peuvent alors vivre dans la crainte. Ils se plaignent d’être constamment
suspectés d’infractions, voire de terrorisme, d’être constamment sous
le regard insistant et inquisiteur des passants, ce qui les amènent
parfois à avoir les nerfs à fleur de peau. Mais plutôt que de réagir
intelligemment en se comportant en citoyens républicains et laïques, et
en démontrant l’inanité de ces accusations, ils donnent raison à leurs
adversaires, ils renforcent les signes extérieurs de religiosité en
portant la robe blanche et la barbe ou le voile noir, très présents dans
les quartiers populaires, en demandant des lieux de prière sur leurs
lieux de travail, en trouvant inadmissible d’être dirigés par une femme,
etc.
Tous ces phénomènes qui exacerbent les différences et provoquent le
rejet sont nouveaux car ils n’existaient pratiquement pas il y a vingt
ans. Ces codes vestimentaires n’appartiennent en rien à la culture de
leurs parents ou grands parents, mais ont été importés du Moyen Orient.
Qui a poussé ces jeunes croyants à se vêtir ainsi ? Qui les pousse à
l’intolérance vis-à-vis de leur propre groupe social ? Difficile à
savoir, mais il est clair que certains font monter la pression pour que
ces jeunes ne s’intègrent pas et s’isolent, en miroir de l’exacerbation
des peurs par le Front national et de sa volonté d’opposer les Français
« jambon-beurre » aux autres. Tout cela est évidemment favorisé par
l’explosion du nombre de chômeurs, la disparition des services publics,
les conflits au Moyen Orient et en Afrique. Mais ces facteurs bien réels
de l’éclatement du vivre-ensemble n’effacent pas le rôle spécifique du
dogmatisme religieux.
L’intolérance vis-à-vis des autres et la mise en avant de ce qui
sépare sont des caractéristiques fréquentes de toutes les religions, qui
peuvent aller jusqu’à la guerre. Qu’on se rappelle les milliers de
protestants assassinés par des catholiques en France lors du massacre
de la Saint-Barthélemy, les massacres de musulmans par les hindouistes
ultra-nationalistes en Inde, les meurtres d’Arabes par des religieux
juifs en Israël dont s’est vanté par exemple le chef du Foyer juif, un
parti de la droite sioniste religieuse israélienne (« J’ai tué beaucoup
d’Arabes dans ma vie. Et il n’y a aucun problème avec ça »), plus
récemment les massacres de Boko Haram au Nigéria. Sur un mode plus
« doux », qu’on se rappelle le combat des fondamentalistes chrétiens aux
États-Unis pour interdire aux femmes de disposer de leur corps, la
Manif pour tous voulant interdire aux homosexuels de vivre comme tout le
monde...
Face à eux, les progressistes ont de tout temps combattu
l’obscurantisme, l’intolérance, le dogmatisme et le fanatisme religieux.
Ce fut en France les luttes anticléricales qui ont permis la laïcité et
la loi de séparation de l’Église et de l’État, la lutte des protestants
pour simplement avoir le droit de l’être. C’est aujourd’hui la lutte
des laïcs en Turquie, en Algérie ou en Israël pour exister face aux
religieux, les luttes contre les hindouistes nationalistes qui cherchent
à éradiquer ceux qui ne le sont pas, c’est le Palestinien Waleed
al-Husseini emprisonné par l’Autorité palestinienne pour sa libre-pensée, ou le blogueur saoudien Raif Badawi, libre-penseur, condamné à
mille coups de fouet et dix ans de prison.
L’actualité de cette lutte explique le soutien inconditionnel à
Charlie Hebdo d’Özgür Mumcu, éditorialiste du grand quotidien turc
Cümhüriyet et fils d’un très célèbre journaliste d’investigation qui
trouva la mort dans un attentat en 1993 : « Nous ne pourrions imaginer
une plus grande insulte faite à l’islam ainsi qu’à son Prophète. […]
Désormais, tout le monde, et en particulier ceux qui placent l’islam au
cœur de leur vie, doivent réfléchir sur les vrais auteurs de l’insulte à
l’islam et à son Prophète en dépassant leur appris par cœur. » Mais
face à lui, des journaux islamo-conservateurs tel Yeni Akit refusent de
condamner les assassinats.
La religion peut être en effet un outil extraordinairement efficace
d’asservissement des peuples, pour leur dénier le droit de choisir leur
avenir. Ce n’est pas le seul outil d’asservissement, mais sa force
particulière et spécifique provient du caractère surnaturel – révélé –
de sa parole qui ne peut donc être discutée. Cet argument qui permet
d’imposer aux autres sa loi, par la force si nécessaire, est un argument
d’autant plus facile que les textes sacrés disent tout et son
contraire : dans la Bible, il y a à la fois amour et violence, et dans
le Coran on trouve des versets prônant la violence et d’autres la
tolérance. Il suffit de choisir ses citations. Cette vision
dogmatique est celle des courants les plus obscurantistes, ceux qui ont
le vent en poupe aujourd’hui, dans une bonne partie du monde, y compris
aux États-Unis d’Amérique.
À l’inverse, de nombreux chrétiens et musulmans, entre autres
croyants, ont justifié le rationalisme contre la tradition ou les
vérités imposées. Ainsi Ibn Rochd (Averroès) prônait dès le 12esiècle la
suprématie de la raison sur la foi, ce qui en fit un précurseur du
rationalisme. Bien plus tard, le théologien protestant Alexandre Vinet
(1797-1847) se montrait un ardent défenseur, non seulement du « droit
d’adopter aucune religion » (en un temps où cela n’avait rien
d’évident), mais du « droit de manifester son incrédulité » : les « voix
ennemies » de la religion doivent pouvoir s’exprimer « aussi librement
qu’elle car il n’y a pas de vraie foi sans conviction ni de conviction
sans examen ». Pour lui, la recherche authentique de la vérité
présuppose l’absence totale de contrainte. À la fin du 19
e
siècle, l’Égyptien Mohammed Abdou, à la suite d’autres penseurs
cairotes un siècle plus tôt, affirmait que dans la question de la loi,
quand la raison prime sur la tradition, il faut suivre la raison. Il y
a quelques semaines, vingt trois intellectuels musulmans ont signé dans
le New York Times un appel vibrant à une réforme de l’islam, pour que
la démocratie vienne avant la religion comme principe organisateur de la
société.
La religion musulmane, dominée actuellement par les courants les plus
rétrogrades, n’a pas toujours été que cela. En Europe, nous devrions
nous rappeler l’époque de l’Inquisition, où les principautés andalouses
étaient à la pointe du progrès scientifique, culturel et artistique,
alors que les évêques inquisiteurs et leurs homologues musulmans
égyptiens ordonnaient de brûler sur la place publique les livres
critiques vis-à-vis des dogmes religieux, comme ceux d’Ibn Rochd. Des
poètes comme les Persans Abû Nuwâs ou Omar Khayyām ont chanté le vin,
l’homosexualité… Des penseurs athées comme le Syrien Aboulala el-Maʿarri
se sont exprimés sans crainte… Ibn Sīnā (Avicenne) est considéré depuis
le 11
e siècle comme le père de la
médecine moderne dont le Canon de la médecine est resté un manuel de
référence en Europe pendant des siècles…
En France, nous avons quelque peu oublié la religion opium du peuple
de Kant, Herder, Feuerbach et Marx. Nous avons oublié notre héritage
anticlérical des 18 et 19
e siècles, la
religion dominante ayant finalement accepté la liberté et ne dominant
plus grand chose. Mais d’autres phénomènes religieux apparaissent, dont
certains sont dangereux pour la liberté, l’égalité et la fraternité :
nous sommes démunis pour en comprendre les ressorts au-delà de la crise
sociale et encore plus démunis pour les combattre. Il est temps de
revivifier le combat laïc et rationaliste.
Il est d’autant plus temps que nous sommes confrontés à plusieurs
religions ou sectes face auxquelles les outils ou le cadre créé par la
loi de 1905 ne sont plus tout à fait adaptés ou méritent une
revalidation.
La question juive, malgré la sécularisation de la religion et les
accords avec l’État français, continue à poser problème du fait de la
confusion entre groupe religieux et groupe ethnique d’une part, et
d’autre part de l’interférence d’un État étranger, Israël, dans
l’organisation et la mobilisation des principales associations juives,
dont le Crif est un bon exemple. Il est difficile de railler la religion
juive ou de critiquer la politique de l’État d’Israël sans se faire
taxer d’antisémite. La frilosité, voire la crispation, des différents
gouvernements français est révélatrice du manque de clarté des pouvoirs
en place sur cette question. Les citoyens ont le droit de critiquer la
religion juive, de condamner la politique israélienne à l’égard du
peuple palestinien, ils ont le droit de condamner la politique de
soutien du gouvernement français à l’État annexionniste israélien.
En parallèle, la religion musulmane a été longtemps maintenue dans
une sorte de non droit avec l’islam des caves, le refus des
municipalités d’accorder des permis de construire des mosquées dignes de
ce nom, l’absence ou l’insuffisance des carrés musulmans dans la
plupart des cimetières en France, les difficultés à ouvrir des écoles
musulmanes. Tout cela a contribué à maintenir cette religion dans un
statut conflictuel.
Les musulmans intégristes auraient tort de se gêner d’exploiter ces
brimades à leur profit. Ils tentent ainsi d’embrigader les laïques de
culture arabo-musulmane dans une guerre de religion avec comme étendards
des symboles qui ne font pas partie des cinq piliers de l’islam, mais
qui sont tous issus d’une interprétation plutôt traditionnaliste et
littérale des textes religieux : le port du voile islamique, voire du
niqab, les menus hallal, les fêtes religieuses, etc. D’ailleurs, même
les textes islamiques prévoient des dérogations quant à l’application
des cinq piliers de l’islam. Par exemple, un musulman est dispensé de
jeûner en cas de voyage ; les femmes ne sont pas autorisées à jeûner en
période de règles ou de grossesse ; les enfants, les malades et les
personnes âgées ne sont pas non plus autorisés à jeûner.
Ces crispations sont d’autant plus fortes que la classe politique
française, dans son ensemble, est peu à l’aise à l’égard de cette
religion.
La confusion entre Français musulmans et Français originaires du
Maghreb, du Proche ou du Moyen Orient, voire même d’Afrique, est
fréquente. En témoignent les différentes gaffes de l’ancien président de
la République à propos des attentats commis par M. Merah à Toulouse et à
Montauban, quand il qualifie par exemple l’une des victimes, soldat
français d’origine maghrébine certes, mais catholique, de « Français
d’apparence musulmane ».
La classe politique et les médias français ont une culture très
superficielle à la fois des civilisations et cultures arabo-musulmanes
et de la diversité des traditions qui en sont issues : il n’y a rien de
comparable entre la tradition et la pratique religieuse musulmanes des
Maghrébins et celles des Moyens Orientaux du Golfe… Ce qui explique le
raidissement des milieux politiques et intellectuels à l’égard de cette
religion et de ses expressions.
Ce raidissement est adroitement exploité par les mouvements
d’extrême-droite français qui exploitent la peur et l’ignorance des
Français quant à cette religion pour en faire un épouvantail contre
l’immigration d’origine maghrébine ou africaine.
D’un côté, ce racisme et cette discrimination manifestes à l’égard de
la population d’origine maghrébine ou africaine s’expriment maintenant
via la religion : il y a trente ans, les immigrés du Maghreb étaient
qualifiés de nord-africains ou de maghrébins ; aujourd’hui on les
appelle musulmans et la lutte contre l’islamisme est devenue un
prétexte.
De l’autre côté, sous la pression des mouvements dit de lutte contre
cette « islamophobie », émerge un mouvement intellectuel français
sympathisant de ces islamistes dits modérés qui prône une attitude
plutôt conciliatrice à l’égard du voile islamique et d’autres
manifestations de l’islamisme en France. Ce mouvement intellectuel joue
le jeu de ces islamistes qui se disent modérés, éclairés ou démocrates,
mais qui n’ont d’autre objectif que d’imposer de fait leur vision et
leur conception rétrogrades de la place de l’islam en France et de
conforter leur mainmise sur la « communauté musulmane ».
Le gouvernement français, par la voix de son premier ministre, vient,
semble-t-il, de commencer à prendre conscience de l’ampleur du fossé
qui sépare les populations de France en parlant d’apartheid territorial,
social et ethnique. Cependant, il ne suffit pas de reconnaitre cet
apartheid de fait, encore faut-il se donner les moyens de le combattre !
Persister dans la politique d’austérité et de restrictions budgétaires
relève de l’insouciance. Même les outils de politique publique dont
s’était doté l’État pour lutter contre ces ghettos se sont étiolés comme
la loi SRU ou la carte scolaire. Ces attentats et la prise de
conscience à laquelle ils ont conduit devraient déboucher sur un vrai
programme de lutte, réaliste, échelonné dans le temps et évalué
périodiquement.
La République ne peut plus faire l’économie d’un vrai débat national
sur la laïcité car les conditions ayant présidé à la loi de 1905 ne sont
plus tout à fait les mêmes, comme on l’a vu plus haut. Le dogmatisme
religieux communautarise le débat politique et sape le vivre-ensemble.
On ne peut lutter contre toute manifestation raciste ou xénophobe à
l’égard de tel ou tel groupe ethnique sans combattre aussi le dogmatisme
religieux et sans se priver du droit légitime de critiquer toute
religion, toute idée, tout dogme, quels qu’ils soient, quitte à
« heurter, choquer ou inquiéter une fraction quelconque de la
population », selon le droit reconnu par la Cour européenne des droits
de l’homme .
Le combat pour l’émancipation est un combat contre les
inégalités sociales, contre le dogmatisme, contre ceux qui veulent
imposer par la force leurs conceptions, qu’ils se prétendent inspirés
par un dieu ou par un homme.
Source de l'info :
Le blog de Robert Joumard
RD